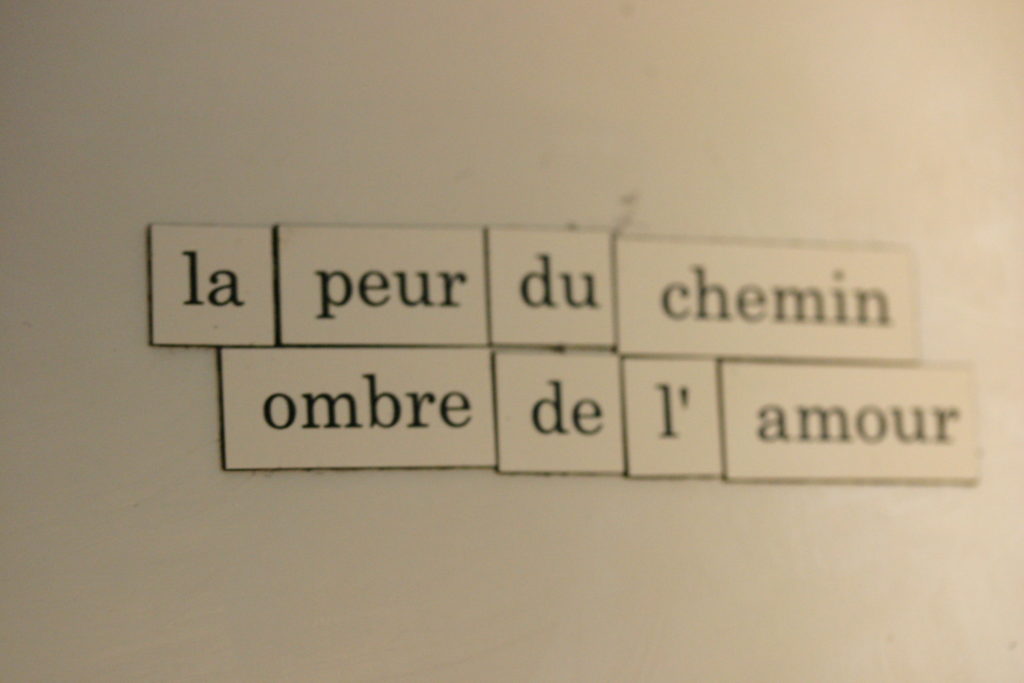
Je pleure, je ne sais pas pourquoi mais je pleure. L’eau de mon corps s’enfuie par mes yeux, mon nez, ma bouche. Je me noie en silence dans mes propres larmes tandis que mes entrailles se tordent d’une douleur atroce et curieusement patiente, insidieuse.
Je pleure, je pleure ta disparition, le vide extraordinaire que ton absence crée dans ma vie. Comment un vide peut-il être créateur ? Je souffre de toi, je manque de toi, je ne conçois pas cette vie sans la tienne à mes côtés, sinon de loin a minima dans le même univers.
Je pleure, je pleure mon existence. C’est si morne et si froid, le feu ne me réchauffe plus le soir en ton absence et notre lit me paraît ne serait ce qu’en pensée glacée quand je l’évoque. Il n’y a rien, peut-être n’y a t’il jamais rien eu. Je n’existe pas au fond.
Je pleure, je pleure sur notre monde qui se noie. La tristesse de cette vie me confine à la violence, à l’automutilation. Je veux détruire ces chairs que je considère comme pourries, je veux débrider cette plaie purulente, je veux en finir. Oui, en finir, un acte définitif, radical.
Et j’attends, j’attends, j’attends.
Et je souffre, je souffre, je souffre.
Je t’aime et tu n’es plus là.
Donc, je t’en veux. Mais tu n’entends pas mes invectives car tu es absent pour toujours.
C’est absurde la vie, ça commence puis ça fini, sans prévenir.
Je pense à toi, j’écris, je dessine, je peins avec violence, avec mes tripes, avec mon sang. Je défigure cette réalité de ma plume, de mon angoisse de mes peurs. J’enfouis ses poncifs stupides sous des tonnes de mots durs, de mots laids, de mots acérés comme des griffes. Je ne me laisserai pas abattre. Je veux briller, je veux briller pour toi.
Tu me manques, amour, ami, frère ou sœur, père ou mère, tu me manques et je t’aime. Je fais de ton absence le réceptacle de ces mots, la sépulture de l’affection, de la complicité, des non dits et des sur dits, des cris et des pleurs, du bruit et de la fureur.
Voilà, tout est dit, tu n’es plus là mais moi je vis, malgré tout, car ma tristesse est sublime.